Bergson, culture et création
| 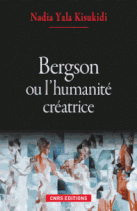 | |
IDEES
Bergson ou l'humanité créatrice.
Nadia Yala Kisukidi.
CNRS Editions.
Octobre 2013.
305 pages.
|
Nadia
Yala Kisukidi est philosophe. Spécialiste de Bergson et de la
philosophie française contemporaine, elle enseigne à l'université de
Genève.
Présentation de l'éditeur.
Politique,
la philosophie bergsonienne ? Engagé dans les affaires de la cité, le
penseur de l'élan vital et de la durée ? La postérité n'a guère retenu
cet aspect dans l'oeuvre immense du prix Nobel de littérature 1927. En
palliant cette lacune, Yala Kisukidi ouvre une réflexion stimulante qui
renouvelle notre connaissance du bergsonisme. De L'Evolution créatrice (1907) aux Deux sources de la morale et de la religion
(1932), elle met en lumière une philosophie politique ambitieuse fondée
sur une métaphysique de la vie. La fameuse distinction du clos et de
l'ouvert joue ici un rôle central : l'homme se réalise dans l'ouverture
nécessairement créatrice, et non dans la clôture (guerre, racisme)
voulue par la nature pour satisfaire des besoins spécifiques. Ce constat
conduit Bergson à promouvoir d'un point de vue philosophique et
institutionnel la démocratie et la défense des droits de l'homme. Yala
Kisukidi redonne à cette pensée toute sa portée actuelle et fait
dialoguer Bergson avec les penseurs contemporains du "post-colonial", ou
des auteurs favorables à une religion et une politique plus ouvertes,
comme Mohammed Iqbal pour l'islam et Léopold Senghor pour l'Afrique..
La recension de Jean-Louis Thébaud. - Esprit. - décembre 2014.
Il
est difficile de relire Bergson aujourd’hui sans se souvenir des
critiques violentes dont il fut l’objet dans la philosophie française
après sa disparition (Georges Politzer, Georges Friedmann) et de la
méfiance que suscitait son engagement officiel dans la propagande de
guerre après 1914. On ne peut, pour autant, négliger son statut dans la
philosophie européenne et même cette gloire que celle de Husserl a
ensuite recouverte, mais qu’il a gardée aux yeux d’auteurs aussi
importants que Péguy, Simmel, Horkheimer ou Benjamin
Mais
surtout, il faut entendre l’extraordinaire salut adressé à Bergson par
Senghor : 1889, déclare-t-il, marque bien le centenaire de la Révolution
et le triomphe de la République, mais cette date revêt en même temps
une toute autre signification puisqu’elle doit aussi être fêtée comme
l’année d’une autre révolution, égale ou même supérieure en importance
historique à la première : la parution de l’Essai sur les données immédiates de la conscience.
Pourquoi faire un sort particulier à cette prise de position de
Senghor ? Parce qu’elle signifie qu’on peut faire du neuf avec Bergson,
que celui-ci entame une révolution culturelle,
que la portée politique de son œuvre, indépendamment de celle qu’il a
pu avoir de son vivant ou jusque dans les années 1950, peut toujours se
charger d’un sens bien vivant.
L’actuel
renouveau de la réception de Bergson, auquel Frédéric Worms se consacre
depuis quinze ans, n’est pas un simple projet relevant de l’histoire de
la philosophie. Après une première « reprise » par Gilles Deleuze, il
s’agit bien de réintroduire Bergson dans les problématiques actuelles de
la réflexion. Dans cet ouvrage, Nadia Yala Kisukidi se propose ainsi de
suivre la réflexion politique de Bergson et identifie dans les thèses
des Deux Sources de la morale et de la religion (1932) une proposition de philosophie de la culture qui couronne toute l’œuvre. Bergson opère dans les Deux Sources
une distinction entre le clos et l’ouvert qui lui permet d’en faire un
critère de jugement moral et politique. La critique vise en particulier
Durkheim et son idée de cohésion de la société. Pourquoi, en 1932, s’en
prendre au fondateur de la sociologie, qui théorisa la République laïque
et influença aussi le socialisme naissant et, à vrai dire, tout
l’ « avant-guerre » ? L’expérience de la guerre de 1914 est passée par
là, après laquelle on ne peut plus entendre, sans y voir un potentiel
monstrueux, la défense d’une société fermée sur elle-même, assujettie à
la loi d’airain de la cohésion et de l’obligation. C’est cette clôture
mortifère que l’ouvert doit briser. Et derrière Durkheim se dessine une
autre cible : Rousseau. Il s’agit bien de sortir de la dialectique du
citoyen patriote, dur à l’étranger, et de « la société générale du genre
humain ». Fausse dialectique, du reste, division inégale car, pour
Bergson, on ne passe pas d’un bord à l’autre, il faut un saut. C’est le
mystique qui, par sa rupture inaugurante, brise le cercle maléfique du
même et ouvre à l’ouvert. L’espèce éclate à l’apparition de l’humanité
et se révèle alors comme retard, obstacle, résistance à l’ouverture.
Résistance à sa poussée et – c’est à ce point que se décide le
bergsonisme – c’est une unique poussée qui est à l’œuvre : la vie.
C’est
ici que les difficultés surgissent. Le concept de vie - et son
immanence _ a-t-il de quoi soutenir une politique ou une philosophie de
la culture ? On devine la grandeur du projet : si nous n’avons plus de
repères transcendants pour nous orienter, s’il ne nous reste plus que
l’expérience de la vie (de la souffrance, du trauma ou de la joie)
peut-on retrouver une ressource immanente dans la vie, dans la pensée de
la vie comme ouverture ? Telle est l’enquête de l’ouvrage, qui établit
que la pensée de l’art et celle de la politique doivent être envisagées
ensemble, à partir de l’idée de création et de vie créatrice.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire